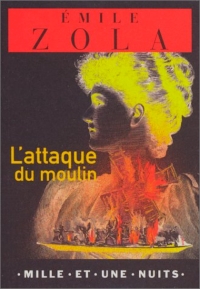|
Lycée Joliot Curie 92000 Nanterre 1S3, 2018-2019 Séquence nº 2: Françoise et Dominique, deux personnages, une histoire d'amour et de mort : « L'Attaque du Moulin » d'Emile Zola (1880)
Résumé court des lectures analytiques et des documents complémentaires
En 1880, dix ans après la guerre franco-prussienne, Zola inaugure avec cette nouvelle le volume intitulé Les Soirées du Medan, qui le consacre comme chef de file du mouvement naturaliste. Les personnages sont deux jeunes gens, Françoise et Dominique, dont le destin se noue en Lorraine durant l'attaque du moulin du père Merlier par les Prussiens, dans un "trou de verdure" devenu enfer. Comment Zola représente-t-il ses deux personnages dans cette histoire d'amour et de mort?
Lectures analytiques 5 Chapitre 1, incipit, extrait, depuis « Le moulin du père Merlier... » jusqu'à « et dont les arbres géants dessinent les colossales corbeilles." Un incipit de récit présente traditionnellement le cadre spatio temporel de l'histoire et ses personnages, fixe le genre, crée le suspens, donne envie au lecteur de connaître la suite. Plus original ici, Zola débute sa nouvelle par la description à la fois réaliste et sensible de Rocreuse et de sa vallée, comme un "trou de verdure". Le texte est marqué à la fois, comme souvent chez Zola, par l'ordre et le détail, notamment grâce aux précisions sur les lieux, et par l'aspect sensible grâce aux sens de celui qui perçoit une nature complètement personnifiée, métamorphosée par enchantement, paisible, harmonieuse, paradisiaque, fertile. Aussi cet incipit est-il en parfait contre-point avec l'excipit de L'Attaque du Moulin, marqué par le feu et l'enfer. 6 Chapitre 1, extrait, depuis "Depuis vingt ans, le père Merlier était maire de Rocreuse..." jusqu'à "... et que jamais elle ne consentirait à épouser un autre garçon." Dans la veine réaliste (avec très peu d'éléments sensibles), Zola brosse ici le portrait du père Merlier et de sa femme, ainsi que de Françoise et de Dominique, les deux protagonistes de la nouvelle. A un premier niveau de difficulté, je vous conseille de dégager en les classant les différents éléments des portraits, à l'aide de la carte mentale de la caractérisation du personnage de roman. En bref: le père Merlier est un vieux veuf aisé qui s'est accompli par le travail, Françoise une jeune fille chétive et laide mais sérieuse et excitant les convoitises, Dominique un étranger beau et séduisant, mal accepté et autour duquel plane une réputation sulfureuse d'homme des bois, de braconnier et de sorcier. Dans une deuxième approche, plus subtile, je vous suggère de mettre en évidence l'ordre objectif et contrôlé de la description, le regard extérieur du narrateur omniscient qui connaît tous des personnages, mais qui,en même temps, les caractérise du point de vue des villageois et des "ruraux" de Rocreuse: mettre en valeur l'importance du paraître, de l'avoir sur l'être, de l'argent, des origines, mais aussi du qu'en dira-t-on et de la superstition. 7 Chapitre 3, extrait, depuis “Ah ! Françoise, reprit Dominique" jusqu'à “Je ferai ce qu'il vous plaira.” Il s'agit d'un passage dialogué du chapitre 3 entre Dominique, retenu prisionnier, et Françoise, qui imagine un plan pour le faire s'échapper. On peut d'abord insister sur le fait que l'intérêt du passage réside dans l'analyse psychologique des personnages, en mouvement, dans le cadre d'un dialogue presque cinématographique, à travers le discours direct et indirect libre. Unis dans l'amour, Dominique et Françoise se différencient en ceci que l'une se révèle prévoyante, organisée, lucide et décidée (c'est elle qui mène le jeu), quand l'autre subit le sort et se révèle passif: "Je ferai comme il vous plaira". Cette analyse des âmes, Zola la mène au plus près des personnages, en prêtant attention à leurs paroles comme le ferait un script. Mais il faut surtout insister sur le fait que le passage revêt une grande force tragique, et relever les éléments de ce registre: la présence de la fatalité, puisque la scène se passe au moment où les jeunes gens devaient se marier, le jour de la Saint-Louis; le thème de la prison sans issue; l'arrivée du jour qui reprend en le subvertissant le motif médiéval de l'aube et celui, plus moderne, du lever du jour où ont lieu les exécutions de condamnés; la présence de la mort avec le couteau que Françoise glisse à Dominique pour égorger la sentinelle qui veille; la force presque surnaturelle du soleil perçu comme un "signal de mort" presque apocalyptique. Dans ces conditions, l'art du récit chez Zola mêle à l'amour des jeunes gens associé à l'Eros, des éléments du Thanatos freudien, avec des échos de Roméo et Juliette qui donnent au passage une tonalité pathétique, profondément émouvante. 8 Chapitre 5, extrait, depuis "- Les Français! Les Français!..." jusqu'à la fin, "... - Victoire! Victoire!" Il s'agit de l'excipit de la nouvelle, à la fin du 5e chapitre. La composition de L'Attaque du Moulin évoque celle des tragédies de l'âge classique (Racine), précisément par ce chiffre 5 mais aussi par une relative unité de lieu, de temps et d'action. Un premier intérêt du passage réside dans son opposition symétrique avec l'incipit du chapitre 1: avec un art du tableau sobre et parfaitement maîtrisé, Zola réalise le dénouement de son récit en faisant libérer Rocreuse par les soldats français, et en plaçant en contre-point à la tranquillité paisible et paradisiaque de la vallée du début, dans un paysage de solitude, la violence destructrice de la fin dans une scène de foule. Il convient de repérer et de commenter les nombreux éléments lexicaux et les figures évoquant le bruit, la violence, la destruction, en insistant sur la personnification du moulin et de la nature, qui souffrent comme des humains ("C'était l'âme du gai moulin qui venait de s'exhaler"), pour relever la dimension pathétique du passage. Mais il faut aussi insister sur un aspect fondamental du texte: le registre tragi-comique. On distinguera d'un côté les éléments tragiques (la mort du père de Françoise et de son fiancé, l'irruption des Français comme figure du destin, les éléments morbides), et, de l'autre, les éléments ironiques et d'humour noir: le rire de l'officier français et son allure de galant soldat d'opérette en total décalage avec l'effarement presque risible de la jeune femme, son entrée théâtrale au milieu du massacre, l'ironie de l'expression "Les Français avaient du canon", enfin l'absurdité du commentaire de l'officier ("Victoire, Victoire!"), encore en décalage. C'est ce double aspect tragique et ironique qui permet à Zola de dénoncer l'atrocité et l'absurdité de la guerre, à travers le destin individuel de deux personnages que la lecture nous a rendus proches et familiers.
Documents
complémentaires Image - «Les dernières cartouches», tableau d'Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville, 1873, représentant la défense de l'Auberge Bourgerie à Bazeilles par le Division bleue, le 1er septembre 1870. Cette peinture tragique exalte le courage d'une quinzaine de soldats français qui ont défendu jusqu'à la mort et jusqu'à la dernière cartouche la dernière maison du village de Bazeilles, dans les Ardennes. L'oeuvre a probablement inspiré Emile Zola. A la fin du XIXe siècle il s'agissait du tableau le plus cher du monde. Au cinéma Georges Méliès s'est inspiré du tableau de Neuville en 1897 dans un court-métrage muet en noir et blanc intitulé Bombardement d'une maison. C'est l'un des premiers films de guerre de l'Histoire. Texte - Emile Zola, entrevue parue dans les Annales de la Patrie en 1876), depuis "Je suis né le 2 avril 1840 d'un père natif de Venise et d'une mère française...", jusqu'à "... et j'ai encore devant moi beaucoup de travail." Zola évoque sa vie et sa méthode de travail. Il a connu des débuts très difficiles et vit replié dans une maison des Batignolles à Paris. Il se définit comme un grand travailleur, il aime son intérieur, son intimité, il fréquente peu d'amis et recheche une vie paisible, consacrée au travail, comme un artisan. A la fin de l'entrevue Zola évoque la grande saga romanesque des Rougon- Macquart et la rédaction de L'Assommoir (1877). Carte - la guerre franco-prussienne, université de Marburg. La carte montre les départements français occupés puis libérés par les troupes prusiennes durant la guerre de 1870, du 19 juillet 1870 au 28 janvier 1871. Au début des hostilités l'Empereur Napoléon III a devant lui une coalition d'États allemands dirigée par la Prusse, et une vingtaine d'autres Etats germaniques. Grâce à cette guerre Bismark va les réunir en un Empire allemand, après la défaite de la France et la signature d'un traité de paix le 10 mai 1871 à Francfort. Entre-temps la défaite de Sedan et la capitulation de Napoléon III ont provoqué le 4 septembre 1870 la chute du Second Empire, l'exil de Napoléon III et la mise en place de la Troisième République. A l'issue de la guerre de 1870 la France perd le territoire d'Alsace-Moselle, et du 18 mars au 28 mai 1871 on assiste à une sanglante révolution, la Commune de Paris. La guerre de 1870 a provoqué en France un profond sentiment de frustration et un désir de revanche, qui expliqueront en partie plus tard son entrée dans la Première Guerre mondiale de 1914-1918. |
|