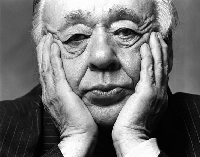|
Lycée Joliot Curie 92000 Nanterre EAF 2016 1ST2S2 (français) Séquence nº 5: la représentation théâtrale du médecin et du malade du XVIIe siècle à nos jours Lecture analytique nº 2 Eugène Ionesco, Le roi se
meurt, 1962, depuis "Ordonne,
mon Roi..." jusqu'à "... Ce n'est que le bourdonnement de
vos oreilles, Majesté."
MARIE,
qui s'est dirigée à reculons vers la droite et se trouve maintenant
près de la fenêtre : Ordonne, mon Roi. Ordonne, mon amour.
Regarde comme je suis belle. Je sens bon. Ordonnez que je vienne vers
vous, que je vous embrasse. LE
ROI, à Marie : Viens vers moi, embrasse-moi. (Marie
reste immobile.) Entends- tu ? MARIE :
Mais oui, je vous entends. Je le ferai. LE
ROI : Viens vers moi. MARIE :
Je voudrais bien. Je vais le faire. Je vais le faire. Mes bras retombent. LE
ROI : Alors, danse. (Marie ne bouge pas.) Danse. Alors, au
moins, tourne-toi, va vers la fenêtre, ouvre-la et referme. MARIE :
Je ne peux pas. LE
ROI : Tu as sans doute un torticolis, tu as certainement un
torticolis. Avance vers moi. MARIE :
Oui, Sire. LE
ROI : Avance vers moi en souriant. MARIE :
Oui, Sire. LE
ROI : Fais-le donc ! MARIE :
Je ne sais plus comment faire pour marcher. J'ai oublié subitement. MARGUERITE,
à Marie : Fais quelques pas vers lui. Marie
avance un peu en direction du Roi. LE
ROI : Vous voyez, elle avance. MARGUERITE :
C'est moi qu'elle a écoutée. (À Marie.) Arrête. Arrête-toi. MARIE :
Pardonne-moi, Majesté, ce n'est pas ma faute. MARGUERITE,
au Roi : Te faut-il d'autres preuves ? LE
ROI : J'ordonne que les arbres poussent du plancher. (Pause.)
J'ordonne que le toit disparaisse. (Pause.) Quoi ? Rien ?
J'ordonne qu'il y ait la pluie. (Pause, toujours rien ne se passe.)
J'ordonne qu'il y ait la foudre et que je la tienne dans ma main. (Pause.)
J'ordonne que les feuilles repoussent (Il va à la fenêtre.)
Quoi ? Rien ? J'ordonne que Juliette entre par la grande porte. (Juliette
entre par la petite porte au fond à droite.) Pas par celle-là, par
celle-ci. Sors par cette porte. (Il montre la grande porte. Elle sort
par la petite porte, à droite, en face. A Juliette.) J'ordonne que
tu restes. (Juliette sort.) J'ordonne qu'on entende les clairons.
J'ordonne que les cloches sonnent. J'ordonne que cent vingt et un coups de
canon se fassent entendre en mon honneur. (Il prête l'oreille.)
Rien ! ... Ah si ! J'entends quelque chose. LE MÉDECIN : Ce n'est que le bourdonnement de vos oreilles, Majesté.
Quelques pistes de réflexion pour une lecture analytique de ce passage du Roi se meurt d'Eugène Ionesco: comique ou dérision?
Introduction Eugène
Ionesco est un dramaturge français d’origine roumaine du XXe siècle
(1909-1994), membre de l’Académie française. Il est, avec Samuel
Beckett (En attendant Godot),
l’un des plus importants représentants du théâtre
de l’absurde. C’est une forme de théâtre qui fait son apparition
dans les années 1950, en même temps que le Nouveau Roman. Le théâtre
de l’absurde est très différent du théâtre que nous connaissons
(classique et baroque avec Molière, Corneille, Racine, du XVIIIe siècle
avec Marivaux et Beaumarchais, drame romantique, etc.). Il essaie de représenter sur scène
des personnages face à leur destin, confrontés à un monde absurde,
sans possibilité de communication, sans Dieu, matérialiste, violent. En
résumé, le théâtre de l’absurde c’est le monde d’après
Hiroshima, d’après les camps, d’après la guerre. Le
Roi se meurt est une tragicomédie, une pièce à la fois tragique et
qui peut, à certains moments, faire rire le public, même si c’est un rire
noir. La pièce montre au public, en une heure trente, la lente agonie et
la décrépitude de Bérenger Ier, le Roi, jusqu’à sa mort. A partir du
moment où il a appris la nouvelle de sa maladie incurable, il passe par
plusieurs phases : déni (refus), révolte, désespoir, puis résignation. Il perd
peu à peu l’usage de ses sens, son pouvoir physique, et surtout moral,
politique : ses sujets ne lui obéissent plus. Deux femmes
accompagnent cette lente dérive du Roi. Marguerite, sa première épouse, est l’allégorie de la mort: elle est lucide, sévère. Marie,
sa deuxième épouse, plus jeune, plus primesautière, lui ressemble (il
est un en somme un bébé grincheux et hypocondriaque comme Argan
chez Molière) ; elle est l’allégorie de la vie, de l’amour, du
désir, de tout ce qui nous retient à la vie. Juliette enfin rappelle
Toinette dans Le Malade imaginaire; elle est femme de ménage,
infirmière, cuisinière et jardinière; elle représente le peuple. On
peut se demander si le passage étudié est comique, s'il prête à rire.
Une telle question surprend a priori. Habituellement la plupart des
lectures de ce texte insistent sur les éléments tragiques,
principalement l'inscription de la mort de Bérenger dès le début de la
pièce, le personnage est voué à accomplir cet acte en 1h30 (unité de temps); sa mort est présentée
comme inéluctable et doit survenir à la fin de la pièce; ses jours sont
comptés. Rappelons que nous sommes au théâtre,
l'un des genres littéraires, avec le roman et la poésie. A l'intérieur
du théâtre on distingue la comédie, qui cherche à faire rire le
public, la tragédie, qui montre au public des héros en proie à la
fatalité, destinés à mourir. Précisons aussi que le théâtre se caractérise
par la double énonciation; en clair cela veut dire qu'un
acteur-personnage énonce toujours ce qu'il dit à deux destinataires
simultanément: 1.
l'autre personnage ou lui-même, 2. le public qui regarde et écoute.
Quels sont donc les signes du textes, dits ou vus, qui font que ce passage
nous fait rire? Pour être plus convaincant répondons à partir
des 4 types de comique traditionnel depuis la farce du Moyen-Âge en
passant par la comédie italienne et Molière: comique de mots, de gestes,
de situation et de caractère. a.
comique de situation Rappelons
la situation de Bérenger Ier, le Roi. Il vient d'apprendre qu'il est
gravement malade et qu'il n'en a plus pour longtemps à vivre. Les
premiers symptômes apparaissent. Il perd peu à peu l'usage de ses sens.
Cela apparaît nettement à la fin du texte, quand il se lance dans une suite
d'anaphores (qui sont des répétitions de mêmes structures
grammaticales, "j'ordonne que..."). Il donne une séries
d'ordres sans effet, et confond son pouls avec les bruits de canon. Le médecin
rappelle Bérenger à la réalité prosaïque ("Ce n'est que le bourdonnement de vos oreilles, Majesté.").
Le roi évoque toujours familièrement le "torticolis" de
Marie. Le même procédé de destruction du discours de Bérenger par de
vulgaires références au réel sera utilisé à la fin de la pièce par
Marguerite dans le texte complémentaire de Ionesco proposé. Cette opposition provoque le rire ou
le sourire. De plus le spectateur voit le Roi complètement manipulé et
téléguidé par
3 femmes qui le dirigent et refusent de l'écouter: Marie, Marguerite et
Juliette, la femme de ménage. b.
Comique de gestes Une
étude attentive du texte et des didascalies montre que Ionesco utilise
également le
mouvement et les gestes pour faire rire. Dans le même essai Henri Bergson
montrait l'importance de tous les procédés mécaniques pour provoquer le
rire su scène, ce qu'il appelle "la boîte à ressort". C'est un procédé classique de
la farce et de la comédie, utilisé par Molière dans l'autre extrait du
bac (Le Malade imaginaire, III, 1). L'exemple le plus frappant se
situe à la fin de notre texte, avec le jeu de
mouvements très rapides entre Juliette et Bérenger, dans un va-et-vient
très comique sur scène, entre la petite et la grande porte. Ce jeu
scénique provoque le rire du spectateur, en même temps qu'il l'interroge car la
porte symbolise la sortie de la vie et la mort. Cet aspect
comique est renforcé par l'opposition avec les gestes
très lents de la première moitié du passage, quand Marie s'approche de Bérenger,
refuse de lui obéir, téléguidée en fait par Marguerite. c.
Comique de mots C'est
ce qui domine ici, avec le comique de gestes. Le plus important est de
noter que le champ lexical du commandement est prédominant: le verbe
ordonner apparaît une dizaine de fois. L comique semble naître en fait de la
contradiction entre l'omniprésence de ce verbe et l'absence d'effet de
tous les ordres du roi, vue et constatée par le spectateur. Toujours lié au comique et aux ordres, on remarque l'utilisation de très nombreux verbes à l'impératif (aussi bien dans la bouche de Bérenger que dans celle de Marie), ou bien à la forme négative, répétée. Enfin,
dans les dernières lignes de notre extrait, les questions rhétoriques
(questions que pose Bérenger et auxquelles il répond lui-même) ont un
effet comique et en même temps un peu inquiétant car elles prouvent un
certain délire excentrique du personnage. d.
Nous insisterons peu sur le comique
de caractère. Le passage fait rire essentiellement car il montre le côté
puéril et enfantin du Roi. La plupart des ordres qu'il donne ne
choquent pas, puisqu'ils correspondent à la vie en action d'un monarque ou d'un chef
d'Etat. En revanche, ce qui surprend et amuse le spectateur, c'est d'ordonner la pluie
et de commander aux feuilles, un peu comme Orphée parlant au vivant et
aux pierres. Dans la psychologie humaine ce comportement animiste (parler aux
choses), correspond à l'enfance, à la magie et,
accessoirement à la folie. Certains psychologues et anthropologues
affirment que dans une phase très ancienne de l'humanité la
collectivité attribuait au chef militaire ou religieux des pouvoirs de
sorcier, notamment celui de commander aux éléments naturels et de s'en
faire obéir. Le jeu de
Béranger sur scène, ses gestes et mimiques, trahissent son caractère enfantin,
assez proche d'Argan aux prises avec Toinette, ou d'Ubu Roi d'Alfred Jarry.
C'est un dernier ressort comique du texte. Conclusion Il s'agissait de montrer en quoi cette scène du début du Roi se meurt d'Eugène Ionesco prête à rire ou à sourire. Réponse: car elle met en jeu les 4 types de comique du théâtre classique avant Ionesco (mots, gestes, situation, caractères), en représentant des personnages non plus comme des fonctions mais comme des symboles. Néanmoins le rire que provoque Bérenger ici aux prises avec 3 femmes est un rire noir, caractéristique du théâtre de l'absurde. C'est plus de dérision que de comique qu'il s'agit. De plus, ce roi qui perd son pouvoir, qui va vers la mort, n'inspire-t-il pas un peu pitié également? Le texte n'a-t-il pas aussi une tonalité pathétique et une dimension tragique? Pathétique, certes, tragique moins. C'est plus un préambule et une porte d'entrée vers le cérémonial progressif de la pièce, vers la déchéance et la lente agonie du Roi. En tant que spectateurs nous sommes "prêts" dès à présent à vivre avec Béranger la triple dimension d'anéantissement du Temps dans le temps de la pièce, selon le philosophe Jankélévitch: irréversible, irrévocable, irrémédiable. La maladie de Béranger va nous sembler sans remède, sauf si jouer et voir jouer constituent une illusion de guérison. C'est peut-être cette alliance de rire noir contenu et cette espérance de mal sans remède qui font l'originalité de cette scène d'Eugène Ionesco. Rebondissement: |
Eugène Ionesco (1909-1994) XXe siècle (20e s.)
|