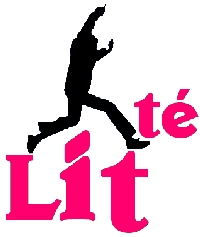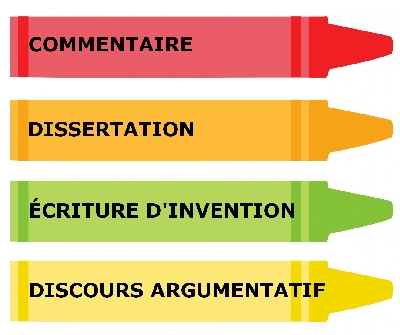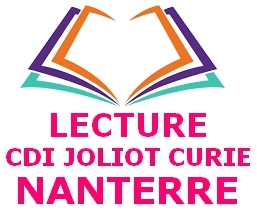|
Mise
à jour du 19 juin 2016 : l'essentiel pour réviser les questions possibles (lors de la
discussion) sur les documents complémentaires de la liste du
Bac.
Séquence nº 1
L'Or de Cendrars
DOC nº 1: la carte du voyage de Johann
August Suter, p. 32
-
Quel est l'intérêt du document?
-
Ce planisphère représente le voyage de Suter,
le héros du roman de Cendrars, depuis Bâle en Suisse jusqu'à Litiz
puis Washington en passant par la Nouvelle-Helvétie, dans sa traversée
de l'Amérique dans les deux sens. Le document précis correspond à
la dimension de roman d'aventures de la fiction de Cendrars, en même temps
qu'il renvoie à la vie itinérante de l'auteur lui-même, grand voyageur.
DOC nº 2: les photos de la vie de Cendrars,
hors-texte p. 96.
Source.
édition "Classiques" Flammarion
Une photo représente
Cendrars posant en uniforme de la Légion étrangère, en 1916, quelques
mois après son amputation. Le poète manchot apprend à écrire de la main
gauche. Les
photos de Cendrars renvoient au caractère autobiographique de L'Or.
Séquence nº 2
Le
héros de roman et son
mentor
DOC
nº 1 - Fénelon, Les Aventures de Télémaque, livre I, depuis
« Télémaque reprit ainsi:...” jusqu’à “tous les maux qui vous menacent."
-
Quel est l'intérêt du document?
-
Cet extrait présente la figure positive de Mentor. Ce personnage possède
le savoir, l'expérience et la sagesse qui manquent à Télémaque. Il le
guide et le réconforte dans les épreuves (ici la tempête et le naufrage).
C'est un maître non pas sévère mais exigeant et bienveillant. Il sourit.
DOC
nº 2 - Choderlos de Laclos, Les Liaisons
dangereuses, Madame de Merteuil et Cécile de Volanges.
-
Que nous apporte ce document par rapport à notre problématique?
-
Il nous présente cette fois un mentor féminin en la personne d'une
libertine, la marquise de Merteuil, confidente de Valmont à qui elle
écrit cette lettre. Elle apparaît comme un mentor négatif, trompeur et
cynique, qui manipule sa jeune élève, la jeune et naïve Cécile de
Volanges, au lieu de faire son éducation amoureuse. On voit ici Mme de
Merteuil préparer un piège à la jeune fille en la jetant dans les bras de
Danceny afin de déshonorer le futur mari de Cécile, Gercourt. Génie du
mal?
DOC nº 3
- Honoré de Balzac, Le Père Goriot, Vautrin et Eugène de
Rastignac
-
Quel est ce mentor de Vautrin?
-
Ici aussi Vautrin apparaît dans le rôle du mauvais mentor. Avec cynisme et
ruse comme Mme de Merteuil, il donne à son apprenti, le jeune Eugène de
Rastignac, une leçon de vie fondée sur la lucidité (le monde est
méchant), pour finalement lui prêter de l'argent et lui faire signer une
reconnaissance de dette à un taux désavantageux. Son sourire trompeur
n'est pas celui de Mentor.
DOC nº
4 - Raymond Queneau, Zazie dans le métro, Folio, p. 125-127
Zazie et tonton Gabriel
-
Qu'apporte ce texte par rapport à notre problématique?
-
En 1959,
en pleine Nouvelle vague du cinéma français et aux débuts de la société
de consommation, on assiste à une espèce de prise de pouvoir des
adolescents, à une remise en cause des modèles éducatifs traditionnels.
Ainsi chez Queneau Zazie fait irruption dans la littérature de manière
non conventionnelle, comme un disciple rebelle qui enfreint toutes les
règles. La « mouflette » en arrive finalement à
supplanter le mentor qu’est l’oncle Gabriel. Il y a donc retournement
complet de l’image du mentor et de sa relation avec l’élève par
rapport à tous les autres textes.
Séquence nº 3
La
poésie amoureuse du Moyen Âge
à nos jours
DOC nº 1 - Portraits de Pierre de Ronsard et de
Cassandre Salviati, édition des Amours.
-
Qu'apporte ce document à notre problématique?
-
La poésie amoureuse est liée ici au modèle antique. Les deux médaillons
représentent Ronsard en poète antique auréolé de gloire, symbolisée par
la couronne de lauriers, et Cassandre Salviati, que les vers amoureux de
Ronsard rendront immortelle.
Les
nombreux éléments analysés en cours se réfèrent à l'antiquité
gréco-romaine, aux sources de laquelle puisent Ronsard et ses compagnons de
la Pléiade.
On
note deux éléments importants: l'intensité du regard des amants en miroir
(l'un des thèmes préférés de la poésie amoureuse), les détails visuels
baroques: motifs floraux et aspect sculptural des portraits.
DOC nº 2 - Pierre Dacco, «Je
t’aime… De plus en plus illusoire… de plus en plus authentique »
-
Quel est le rapport entre ce document complémentaire et les textes de
poésie amoureuse du corpus?
- Les textes sont des
exemples de transformation, par le prisme de l'écriture poétique, de cette
relation humaine appelée amour. Disciple de Charles Baudouin et de Carl Gustav
Jung, Pierre Dacco en tant que psychothérapeute fait de cette relation une
interprétation psychanalytique et non pas littéraire et esthétique.
Cette lecture nouvelle peut nous aider à mieux comprendre le(s) sens de la
poésie amoureuse.
DOC nº 3 - Juliette Gréco, « Si tu t’imagines »
(paroles de Raymond Queneau)
-
Qu'apporte ce texte à notre réflexion?
-
Il est utile de relier cette chanson de Raymond Queneau à l'ode à
Cassandre de Ronsard ("Mignonne, allons voir si la rose...). À quatre
siècles de distance on observe la permanence du motif du carpe diem, avec
des expressions similaires. À ceci près qu'au XXe siècle le poète
Queneau situe son texte au niveau du "néo-français", quand
Ronsard place son ode dans le cadre courtois et aristocratique qui fut celui
du milieu culturel où il évoluait à la Renaissance.
Séquence nº 4
Le
discours contre la pauvreté
de la Renaissance à nos jours
DOC nº 1 - Abbé Pierre, Appel du 1er février
1954
-
Quels sont les points communs
et quelles sont les différences entre cet appel de l'abbé Pierre et
le discours contre la misère de Victor Hugo en 1849?
-
Les deux textes sont des textes d'argumentation directe pour convaincre d'agir en urgence devant une situation humaine
urgente, alliant le subjectif et l'objectif, le matériel et le spirituel. Mais Hugo parle aux représentants du peuple de fonder une loi durable,
l'abbé Pierre s'adresse directement au peuple pour une action vitale et de
portée immédiate:
"Aimons-nous assez tout de suite pour faire cela..." Les deux
discours ne sont peut-être pas contradictoires: résoudre un problème
aussi grave que la misère suppose à la fois une action urgente (l'aide
solidaire) et une réflexion profonde, sur la durée, qui passe par la
loi.
DOC nº 2 - Jim Yong Kim, Président de la Banque
mondiale, “Un monde sans pauvreté est à notre portée”, allocution du
3 mai 2013
-
Quel est l'intérêt du document?
-
Le discours de Jim Yong Kim présente le point de vue d'un banquier sur les
solutions possibles au problème de la pauvreté. Il est marqué à la fois
par l'aspect technique et par les anaphores destinées à
capter l'attention de l'auditoire. Le président de la Banque Mondiale
insiste sur la nécessité d'une prospérité partagée et juste. Il
rejoint l'abbé Pierre sur la notion d'urgence, et Jaucourt dans
l'Encyclopédie quand il réfute le lien entre pauvreté et fatalité. Il
utilise enfin l'argument d'autorité en citant Martin Luther King.
DOC nº 3 - Louis Le Nain, Repas de paysans, 1642, Musée du Louvre
-
Quel est le rapport entre ce document iconographique et la problématique
traitée dans la 4e séquence?
-
Ce tableau réaliste de Louis Le Nain représente un pauvre (l'adulte assis
à droite) dans un intérieur paysan caractérisé par des éléments
connotant la modestie et une certaine aisance. Cette richesse relative est
matérialisée par les vêtements, le violon, la cruche et les verres de
vin, le foyer, le pain blanc entamé sur la table, le chein comme animal
domestique, ce qui ressemble à un tonneau. Le paysan aux pieds nus dénote
par rapport aux autres personnages (3 adultes, 3 enfants): ses vêtements
sont déchirés, il est humble, résigné, fatigué, un peu comme le
laboureur de La Fontaine. Sans doute vient-il d`être "loué" par
le personnage central; on boit pour fêter l'affaire.
-
N'y a-t-il pas une dimension religieuse, mystique, dans ce tableau?
-
Si, peut-être des symboles chrétiens: le pain et le vin évoquent la
communion, l'eucharistie. D'ailleurs le pain blanc (le pain des riches,
qu'on pourra partager hors-cadre) est au centre géométrique du tableau,
comme un point du triangle reliant les deux verres et le vin. Le message de
Louis Le Nain plaiderait en faveur de la solidarité tout en montrant la
présence matérielle du divin. C'est une autre lecture possible du tableau.
DOC nº 4 - Gustave Doré, gravure pour les Contes
de Perrault, édition Hetzel, 1862, "Le
Petit Poucet "
-
De quelle manière originale Gustave Doré dénonce-t-il la misère?
-
L'art
de Gustave Doré consiste à graver au burin des regards qui parlent. La gravure
n'est pas réduite à un rôle d'ornementation mais devient un véritable
objet de narration. L'art visuel vise ainsi à dénoncer la pauvreté par l'émotion et par d'autres moyens que ceux du discours.
Pour
plus de détails lire mon corrigé
du devoir à la maison.
-
Quel est l'intérêt du document?
-
Il peut être mis en relation avec le conte de Charles Perrault, Le
Petit Poucet. Ce rapprochement entre le texte et l'image fait que l'un
éclaire l'autre.
DOC nº 5 - Kieron M. Dwyer,
dessin satirique paru en 2001 sur www.lcdcomic.com
-
Quel est l'intérêt du document par rapport à notre problématique de la
4e séquence?
-
Ce dessin satirique oppose visuellement le blanc et les non-blancs, par le
jeu des couleurs. Le comique naît du renversement de situation: le blanc
représenté en uniforme colonial passe de conquérant prédateur à victime
des soi-disants cannibales. Dans le texte des bulles, le jeu de mots
renforce le comique, avec deux sens: jouer avec la nourriture (une
interdiction faite habituellement aux enfants par les adultes), jouer aux
échecs (avec un partenaire). L'oeuvre de Kieron M. Dwyer peut être mise en
relation avec le texte de Jonathan Swift, "Du bon usage du
cannibalisme" (1729) par son sens de la dérision. L'écrivain
irlandais propose dans ce texte étudié en lecture analytique une solution
radicale au problème crucial de la pauvreté: autoriser le cannibalisme
sélectif sur les bébés pauvres (sic).
Récurrence
du motif de la nourriture, toujours associé à celui de la pauvreté.
Lecture cursive: Charles Perrault, "Le
Petit Poucet", Les Contes de ma mère l'Oye, 1697.
Par sa
fonction éducative, édifiante, un conte pour enfants comme celui de
Perrault peut non seulement dénoncer la pauvreté mais aussi offrir aux
enfants et donc aux futurs adultes les moyens de l'éviter, de
l'affronter, d'y faire face. En quelque sorte ce qui est dénoncé ici,
c'est surtout l'image de la pauvreté comme fatalité.
Télécharger l'oeuvre, les questions
et, pour les détails, le corrigé proposé.
Séquence nº 5
La
représentation théâtrale
du médecin et du malade du XVIIe siècle à nos
jours
DOC nº 1 - Eugène Ionesco, Le roi se
meurt, depuis "Il
perçoit encore les couleurs..." (Marguerite) jusqu'à "... Tu
peux prendre place."
-
Quel est l'intérêt de ce document?
-
Le document permet de comprendre l'évolution de Bérenger depuis le début
de la pièce. Il a progressivement perdu tout pouvoir sur les autres et sur
son propre corps. Il se réfugie dans les bras de Marguerite,
allégorie
de la mort dans toute la pièce, contrairement à Marie qui représente la
vie et la sensualité. Bérenger se dématérialise
et devient un fantôme
comme chez Shakespeare,
l'ombre de lui-même. On note par ailleurs la dimension cérémoniale de
l'extrait proposé, qui correspond à un rite de passage
du monde des vivants au monde des morts,
bien mis en évidence par la mise en scène. En même
temps tous
les commentaires ironiques
de Marguerite pour dire à Bérenger (et donc à nous public) que tout ceci
n'est pas réel, que tout finalement n'est qu'une illusion... théâtrale,
donnent à l'extrait sa tonalité tragicomique, en particulier par les
allusions au théâtre lui-même (La vie est un songe de Calderón de
la Barca, la Marguerite du Faust de Goethe).
Lecture cursive: Jules Romain, Knock ou le
Triomphe de la médecine, 1923.
-
Quel est le lien entre cette comédie de Jules Romain et la problématique
abordée dans la 5e et dernière séquence?
-
Le médecin et le malade y sont représentés, comme dans Le Malade
imaginaire de Molière et Le Roi se meurt d'Eugène Ionesco, mais
davantage dans la tradition comique de Molière. Avec toutefois des
différences au-delà des ressemblances.
Knock
est un faux médecin avec de faux diplômes, qui gruge ses malades, qui,
eux, sont vrais, à la différence d'Argan l'hypocondriaque. La scène où
Knock ausculte le gendarme reprend les procédés comiques de l'acte III
scène 1, quand Toinette déguisée en médecin joue un tour à Argan et
l'effraie. Dans les deux cas c'est la sottise des malades crédules qui est
dénoncée, ainsi que l'incompétence de la médecine et l'abus de pouvoir
du médecin, dans une visée satirique et comique.
Chez
Ionesco, même si elle prête souvent à rire par les allusions à
l'inter-texte théâtral (les pièces du répertoire auxquelles il est fait
allusion), la situation du malade est vue du point de vue de la déchéance
et de la lucidité, qui consiste à refuser l'éternité et à se jouer de
l'illusion théâtrale.

|